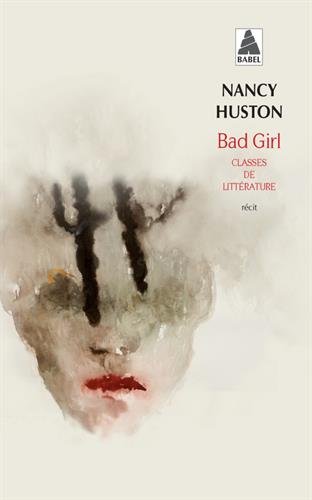Traduit par Cécile Arnaud
6 décembre 2013, Johannesburg se réveille avec l’annonce du décès de « Tata Mandela ». Gin prend sa douche. Artiste vivant à New York depuis une vingtaine d’années, elle est revenue dans sa ville natale avec l’idée d’organiser une fête pour les quatre-vingts ans de sa mère, Neve Brandt. September, SDF bossu, se réveille sur ses cartons aplatis et trempés par la pluie. Mercy, employée de maison, s’affaire dans la cuisine de Mme Brandt, tout en écoutant la nouvelle à la radio. Dans la maison voisine de celle des Brandt, Duduzile s’apprête à réveiller ses patrons avant d’aller voir son frère, September. Au Diamond, Peter, juriste pour une société minière, est déjà au bureau, sans pour autant avoir quitté des yeux de l’écran de télévision.
24 heures à Johannesburg, le jour de la mort de Mandela, c’est exactement ce que vous allez vivre, du point de vue de plusieurs personnages, des Blancs et des Noirs, des riches et des pauvres, dans cette ville où « la mort [est] toujours si proche, (…), la menace gratuite atten[d] derrière chaque porte en se léchant les babines » . Au fil des pages, l’ambiance va devenir suffocante, l’orage menaçant, jusqu’au coup de tonnerre qui percera les nuages.
Fiona Melrose préface son livre avec une citation de Mrs Daloway de Virginia Woolf. Rien d’innocent, puisque toute la construction de Johannesburg est similaire au roman de l’auteure britannique. De l’action sur une journée, dans une ville précise, en passant par le procédé du flux de conscience. Vous vivrez cette journée particulière à Johannesburg de plusieurs points de vue, à travers la conscience de plusieurs personnages.
Une belle manière de dénoncer tout en essayant de comprendre la souffrance morale et psychique de chacun, présente et passée. Une façon aussi de laisser le lecteur juge. N’empêche, vous finirez le roman dans un drôle d’état ! 🙂 J’ai dû laisser passer une bonne journée avant d’arriver à me replonger dans un autre livre.
L’auteure, à l’instar de Virginia Woolf questionne l’alterité. Mais aussi l’injustice persistante en Afrique du Sud. La peur. Cette peur qui paralyse, empêche d’avancer et de se comprendre. Des grands portails télécommandés qui dissimulent des maisons cossues, des vitres, le bruit de la rue, font qu’on peut difficile entendre l’autre. Johannesburg, ville fractionnée en multitude d’espaces où chacun vit comme dans une bulle.
Il est aussi question de la misère qui côtoie la richesse, de l’hypocrisie. L’Afrique post-apartheid n’est pas encore un paradis pour tout le monde !
Neve Brandt incarne l’Afrique du Sud blanche du passé. Pour elle, un chien semble avoir plus d’importance qu’un humain, de toute façon. Elle va bientôt mourir. Juno, la chienne, semble bien plus intelligente que sa maîtresse.
September vous fend le coeur : il est l’exact opposé de cette femme : le Noir victime, par le passé, de l’autoritarisme et du racisme blanc.
Entre les deux, il y a Gin et Peter, personnages imparfaits mais tourmentés, plein de remords et de questionnement :
« L’abîme s’ouvrit. Infini, ancien et noir. Que s’était-il passé ? Pourquoi tout était-il tellement difforme ? Les agapanthes autour de son cou, son visage fracassé, sa terrible bosse enflée. Il était allé au Diamond, et Peter l’avait vu (…). Il avait ramené Juno à la maison, l’avait tenue calée au creux de son bras, puis il était parti au Diamond. Elle l’avait laissé partir. »
Fiona Melrose esquisse également (mais peut-être trop brièvement) les relations entre les différentes ethnies noires du pays, pas toujours si limpides : Zoulous, Sothos, Xhosas, et immigrés zimbabwéens : « Joséphine ne faisait pas pareil que les autres. Peut-être parce qu’elle buvait. Elle prétendait que durant la semaine, quand ses employeurs étaient au travail, elle passait l’après-midi avec une bouteille de vin. Elle préparait leur dîner puis se retirait dans sa chambre pour regarder la télévision avant leur retour (…). Mercy avait du mal à y croire, et si c’était vrai, il n’y avait pas de quoi se vanter. Elle attribuait ce manque de fibre morale au fait que Joséphine était zimbabwéenne. Ces Kalangas étaient tous les mêmes. Aucune autre femme ne se comportait de cette façon. » Le destin de September est à cet égard édifiant.
L’événement majeur de la journée n’est pas le même pour tout le monde : la fête d’anniversaire pour les uns, l’hommage à Mandela pour les autres. Cependant, le roman est porteur d’espoir.
« Gin se sentit asphyxiée, étranglée par cette beauté, les bougies, les chants, les arbres en surpomb d’où tombaient des restes de pluie à chaque rafale de vent. Les présentateurs télé, déconcertés et graves, et les générateurs des camions régie ronronnaient en fond sonore sous la musique.
C’est ça, la sensation d’être chez soi.
Gin savait que depuis des année, elle était cette astronautes envoyée dans l’espace, qui voyageait à travers l’obscurité infinie, seulement guidée par les étoiles, et qui cherchait encore et toujours à rentrer chez elle. »
Johannesburg, violente, bigarrée, difforme, injuste et en effervescence permanente m’a engloutie de la première la dernière ligne. J’en suis ressortie à la fois secouée et éblouie. La plume de Fiona Melrose, ciselée et complexe, vous embarque dans un sacré voyage. J’ai adoré !
Merci aux éditions de La Table Ronde.
«