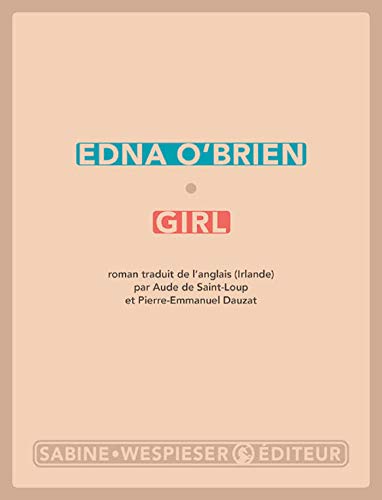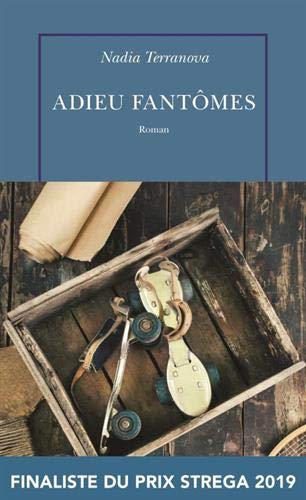Traduit par Sarah Tardy
J’ai laissé passer la déferlante du printemps dernier qui nous a mis sous le nez, en boucle, le dernier livre de Maggie O’Farrell. Car au bout d’un moment, quand on voit toujours le même livre en boucle sur les réseaux, perso, ça me saoule un brin et je m’en détourne. D’autant qu’au même moment sont sortis d’excellents romans irlandais qui sont passés presque inaperçus sur le web.
Il me restait dans ma PAL 4 livres d’auteurs irlandais publiés entre août 2018 et le printemps dernier : Miracle du sang de Lisa McInerney ; D’os et de lumière de Mike McCormack ; Rien qu’une vie de Graham Norton ; I am, I am, I am de Maggie O’Farrell. Sauf qu’en écrivant ces lignes, je m’aperçois qu’en fait il y en a 5 car j’ai oublié Les amants de Coney Island de Billy O’Callaghan (planqué dans ma liseuse) :p . J’étais limite en panne de lecture en train de tourner en rond devant ma bibliothèque, incapable de choisir mon prochain roman irlandais. J’ai demandé aux copains sur Instagram et ils ont majoritairement désigné Maggie O’Farrell. Donc, voilà, je l’ai ENFIN lu ! 🙂
J’ai lu tous les romans de l’auteure sauf un (le fameux « sauf un » qui fait suer !). Ils sont tous chroniqués sur le blog. J’ai eu des hauts et des bas avec Maggie O’Farrell, je trouve ses livres assez inégaux. Sans doute une des raisons supplémentaires qui ne m’a pas fait me jeter dessus à sa sortie.
Comme tout le monde le sait déjà, I am, I am, I am n’est pas un roman, mais une autobiographie centrée sur « 17 rencontres avec la mort », comme l’indique le sous-titre. 17 fois où l’auteur a croisé la Grande Faucheuse venue pour elle ou ses enfants. Les chapitres se focalisent sur diverses parties de son corps et développe la manière dont elles ont été meurtries : le cou (1990 et 2002) ; les poumons (1988, 2000 et 2010) ; la colonne vertébrale, les jambes, le bassin, l’abdomen, la tête (1977) ; le corps tout entier (1993) ; le ventre (2003) ; bébé et système sanguin (2005) ; le système sanguin (1991) ; la tête (1975) ; le crâne (1998) ; les intestins (1994) ; le système sanguin (1997) ; cause inconnue 2003 ; le cervelet (1980) ; ma fille aujourd’hui.
La construction d’un point de vue anatomique et anachronique est indéniablement originale. Certains récits sont émouvants et/ou révoltants, notamment ceux liés à la maternité, à la maladie neurologique contractée par l’auteure. Mais la « surprise » est finalement le dernier chapitre, dédié à la maladie de sa fille, atteinte d’une forme grave d’allergie à tout, qui lui fait risquer sa vie à chaque seconde, la forme la plus visible étant un eczéma aggravé. Dans les remerciements, on découvre qu’une donation sera faite à la Anaphilaxis Campaign grâce aux recettes de ce livre.
On ne peut pas rester indifférent au calvaire de la petite atteinte d’anaphylaxie et à la vie de ses parents, en état d’alerte permanent.
« Ma fille souffre de réactions allergiques, de divers degrés de gravité, douze à quinze fois par an en moyenne. Je tiens un journal détaillé. Ma fille est née avec un déficit immunitaire, ce qui signifie que son système ne réagit pas suffisamment face à certaines choses, et trop face à d’autres. Un simple rhume pour les autres enfants signifie un séjour à l’hôpital pour elle, avec un respirateur artificiel et perfusion. » Cette maladie signifie aussi un bébé défiguré par son eczéma, une plaie vivante.
« A l’âge d’un mois, son corps était comme piégé dans un plâtre blanc et cru, celui de l’eczéma. Sa peau craquait lorsqu’elle pliait le poignet, le bras, la jambe ; la maladie avait envahi le moindre millimètre de peau, la moindre fissure (…). L’eczéma dans sa forme la plus grave peut être dangereux voire mortel » pendant que la pédiatre se contente de prescrire froidement la même crème totalement inefficace. Et vous, lecteur, vous bouillez de colère, à l’instar de l’auteure (pour avoir vécu le même genre de situation de médecin incompétent, incapable de vous donner une adresse de spécialiste) !
Un espoir émerge le jour où Maggie O’Farrell parle du problème de sa fille à une amie qui lui conseille l’adresse du meilleur spécialiste qui exerce en médecine privée. Là, moi-même je sais qu’on s’assied sur tous ses principes et qu’on fonce, même si on doit y laisser beaucoup d’argent. Même si cette médecine à double vitesse vous révolte.
L’autre récit qui m’a marquée est celui où elle explique son accouchement (« Ventre, 2003), dans un hôpital qui lui refuse la césarienne. Elle a beau expliquer qu’elle a une maladie qui l’empêcheront d’accoucher par voie basse, les médecins lui refusent sous prétexte que c’est « la césarienne est un culte, une mode. Qu'[elle] a lu trop de magazines féminins » ! (Je rêve !!!) Le médecin ajoute qu’une césarienne est un acte chirurgical lourd. Et alors ??? On devine toute de suite les histoires de gros sous qui se cachent derrière de telles affirmations. 😦
« Les médecins, dissimulés derrière un rideau hissé à la hâte, laissaient des empreintes de pas rouges en se déplaçant. L’une d’entre eux, une jeune femme nord-irlandaise, qui paniquait, était en train de dire, « Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire. » « (déjà, youpi, c’est hyper rassurant !)
« (…) j’étais allée à mon rendez-vous avec la chef de clinique d’un grand hôpital londonien (la même chef qui, quelques mois plus tard, s’exclamerait « Je ne peux pas, je ne peux pas », je ne sais pas comment faire, pendant que je serais en train de saigner sur la table d’opération). Je lui avais expliqué qu’enfant j’avais contracté un virus à cause duquel j’avais passé un an en fauteuil roulant et gardé une faiblesse musculaire ainsi que des dommages nerveux et cérébraux. Les neurologues et les pédiatres qui m’avaient suivie à l’époque m’avaient dit que, si je voulais un jour, avoir des enfants, il me faudrait une césarienne. (…) A peine étais-je arrivée à la moitié de mon discours que la chef de clinique m’a interrompue d’un ton nerveux.
« Il faut que j’en parle à un spécialiste », a-t-elle dit avant de sortir en trombe du cabinet. » Et le spécialiste de répondre : « Vous n’avez aucun problème, a-t-il conclu après deux pas. Vous accoucherez normalement. » Le médecin va jusqu’à mettre en doute sa maladie, lui demande des preuves. Moi, je faisais des bonds en lisant ces lignes ! Maggie O’Farrell souffre l’ataxie. Comment un homme, et une femme, de surcroit médecins, peuvent imaginer qu’elle fabule ? Comment est-ce possible qu’encore au XXIe siècle, dans des pays développés on vous nie en tant que femme de disposer d’une méthode d’accouchement qui vous permet d’éviter d’y laisser votre vie (et celle du bébé) ? Comment peut-on se permettre de vous laisser souffrir en toute connaissance de cause et au nom de quotas ?
« Mourir en couches semble être un danger totalement daté, une menace extrêmement lointaine entre les murs des hôpitaux des pays développés. Mais une enquête récente a classé le Royaume Uni 30e sur 179 pays en matière de taux de mortalité maternelle. Au Royaume Uni, les femmes ont une chance sur 6 900 de mourir en donnant naissance à leur enfant, ce qui surpasse de loin les risques encourus en Pologne. (…)
La cause la plus répandue de mortalité maternelle dans le monde est l’hémorragie post-partum. »
On peut remercier Maggie O’Farrell de dénoncer ces pratiques et attitudes d’un autre âge. Pour des raisons économiques.
Ces deux récits qui m’ont fait le plus réagir, qui avaient le plus d’intérêt parce qu’ils dénoncent des attitudes médicales inacceptables. Parce qu’il faut se battre comme un diable pour obtenir des diagnostics fiables devant des médecins incompétents qui refusent de vous donner le nom d’un confrère pour une raison ou une autre.
Les autres historiettes où Maggie O’Farrell raconte ses agressions, sa noyade (ratée), sa dysenterie amibienne et d’autres choses (dont je ne me souviens déjà plus), m’ont laissée beaucoup plus indifférente, sans doute parce que c’est davantage autocentré. Souvent, mon attention divaguait ailleurs, sans que je sache vraiment identifier pourquoi, si ce n’est que je m’ennuyais et que je me demandais pourquoi elle nous racontait ça.
Dans un registre similaire, Emilie Pine m’a beaucoup plus touchée car il y a une dimension féminine universelle dans ses essais, même si elle parle d’elle, que je n’ai pas retrouvé ici.
Un avis mitigé, donc pour une lecture en dents de scie où je me serai bien contentée que de certains chapitres .
Le but affiché de ce livre est de récolter des fonds pour la recherche contre l’anaphylaxie (on peut totalement le comprendre) et de dénoncer des pratiques médicales douteuses (du moins c’est ce que j’en ai perçu). C’est pour moi tout l’intérêt de cette oeuvre.



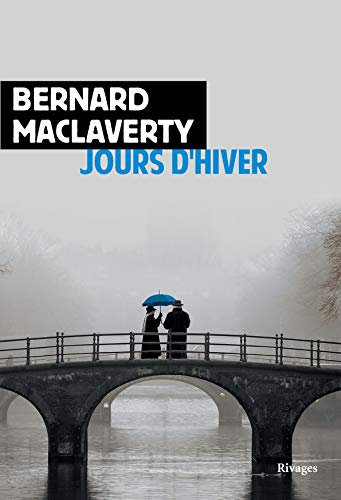






 Sachez-le, cette ville dévore les rêves des jeunes filles qui veulent devenir actrice.
Sachez-le, cette ville dévore les rêves des jeunes filles qui veulent devenir actrice.